Dans ce deuxième article consacré au viol et l’art, (lien vers l’épisode 1) qu’on ne se méprenne pas sur le choix du masculin, pourquoi décrire Christine Angot comme un écrivain et non pas comme une écrivaine ? Personnellement, entendre clairement le suffixe -vaine me semble moins féministe qu’au masculin, mais c’est complétement subjectif, les adjectifs vain et vaines qui me font penser à useless (soit en français inutiles), étant tous les deux durs à entendre pour un auteur, surtout quand vous cherchez à partager quelque chose de viscéral et d’important.
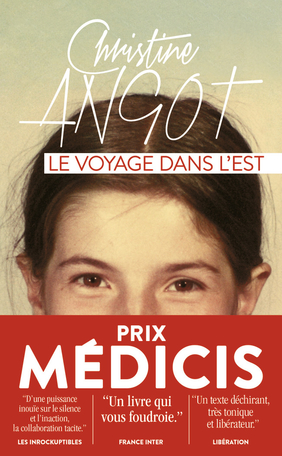
Pourquoi ne pas employer le mot auteure, avec un -e ? ou encore autrice ? ou romancière ? Faisant fi des critiques à venir, j’ai eu envie d’employer le langage dominant, ce masculin qui l’emporte toujours sur le féminin, pour évoquer, le parcours de cette femme, que je n’ai jamais rencontré et dont je sais pourtant de nombreux détails du calvaire qu’elle a subi. Parfois, cela me prend : j’ai envie de m’exprimer comme les chefs autoproclamés. Bref, j’utilise le masculin parce que j’ai envie, c’est ma posture, c’est mon article, ce sont mes mots, je suis encore libre d’écrire ce que pense et ce que je veux. Et les gens mécontents sont libres de ne pas lire.
Pourquoi cet article ?
Nous avons une série d’articles intitulée Le viol et l’art. L’inceste, viol familial reste tabou malgré quelques articles à sensation. Christine Angot a le courage d’affronter son passé et de faire réfléchir au discours dominant sur le sujet, notamment à travers son art, ses livres. C’est sans doute pour cela qu’elle en dérange certains…et aussi pourquoi il était évident d’écrire sur elle.
UN TEMOIGNAGE SUR LE LANGAGE QUI RESONNE AVEC L’EVOLUTION DE NOTRE SOCIETE CONNECTEE EMPLIE DE MOTS CENSURES
Christine Angot je la connais. Quand je dis « connaitre » Christine Angot, soyons clairs, c’est uniquement au travers de ses écrits. Ce sont les événements douloureux qu’elle relatent qui me la rende familière : par exemple, dans Le voyage dans l’Est, quand elle décrit son incapacité à trouver ses mots pour repousser la main qu’a posé son père sur son genou, puis sur sa cuisse, je ressens une identification, comme si son écriture réactivait mes souvenirs et sensations, tout en sachant que ce n’est pas vraiment la même chose : je n’ai pas été victime d’inceste et l’aurais-je été nos histoires auraient été forcément différentes. Mais je sais ce que c’est que de ne pas parler correctement une langue et de ne pas trouver ses mots. Je sais ce que c’est d’être troublé dans l’expression de ses émotions parce quel que soit le vocabulaire que vous emploierez l’autre en face vous écrasera de sa supériorité langagière, économique ou physique.
Il serait indécent de voler la vérité et l’expérience de chacune d’’entre nous. Aucune douleur, aucun dégoût ne sont comparables. Pourtant, en racontant cet événement dans son livre, Christine Angot aborde plus que l’autofiction et la question du viol. Elle aborde la question de l’indicible et en quoi le langage censuré participe à l’objectivation des femmes. Elle explique comment de manière insidieuse les victimes sont réduites au silence même en parlant. Elle déjoue les biais cognitifs qui nous font croire que notre société est davantage à l’écoute qu’autrefois sur ces sujets alors qu’en fait nous n’allons pas plus loin que cette formule empathique : on vous croit.
En lisant Le voyage dans l’Est, cela m’a aussi fait réfléchir à la tendance actuelle de la censure de certains mots sur internet, notamment sur les plateformes de contenus.
Sur les plateformes et réseaux sociaux, pour ne pas être démonétisé, les créateurs de contenus, masquent ou bipent les mots qui pourraient choquer l’auditoire mais surtout la compagnie qui les rémunèrent. Parfois, c’est obligatoire, ils n’ont même pas la possibilité de faire autrement. S’il est normal qu’il existe des règlements, cette tendance est cependant pernicieuse.
En effet, le risque est de montrer au public, notamment les jeunes générations qui sont les principaux consommateurs de ces contenus, que, publiquement, on ne peut plus dire des mots comme viol, guerre, violence domestique, sexuelle, anorexie, boulimie, suicide, pour n’en citer que quelques-uns. Ils sont systématiquement floutés, bipés, en un mot escamotés. Inconsciemment, cela met dans la tête des gens que les mots désignant des actes qui les ont fait souffrir ne seront pas pris en compte et pas entendus. En gros, on peut parler…mais dans les limites de l’entendable.
Cette pratique de biper le langage, qui était autrefois en pratique aux USA et pas en Europe, est largement aujourd’hui systématique, hélas. Est-ce que cette pratique ne contribuerait-elle pas à réduire les gens au silence ou à s’autocensurer? On sait que les Etats-Unis d’où proviennent cette habitude, marchent sur la tête depuis de nombreuses années entre wokisme et théorie du complot, pourquoi copier le pire de ce pays qui a sans doute d’autres choses plus bénéfiques à nous offrir ? Réseaux sociaux : laissez les gens parler avec le vocabulaire de leur langue ! Les gens : soyez fiers de votre singularité, arrêtez de vouloir ressembler à des gens qui ont une culture différente, beaucoup plus puritaine que la notre.
QUAND L’AUTOFICTION DENONCE LA VIOLENCE SOCIALE ET ECONOMIQUE
Christine Angot raconte comment son père s’est cru au-dessus des lois car il venait d’une classe sociale supérieure à la sienne. Dans Un amour impossible, aussi bien dans le livre que dans le film qui en a été adapté, il est question de violence sociale, d’une punition de la mère qui a voulu s’élever socialement. Pour le père, violer la fille serait une manière de rabaisser et de détruire indirectement la mère.
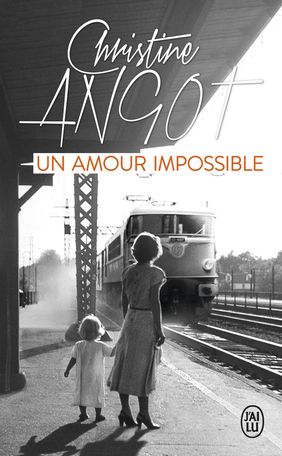
Cet enjeu « économique et social » nous ramène à la censure des mots sur les réseaux. Concernant le « bipage » des mots polémiques sur les médias et réseaux sociaux, il s’agit en apparence d’une censure économique, puisque sa mise en place par des plateformes de contenus, consiste en la menace et/ou la punition d’une démonétisation, ce qui est encore une fois l’illustration de la violence du marché, de la société de consommation car dans un pays qui revendique la liberté de la presse, pourquoi accepter d’avoir des mots bipés, censurés ? On passe ici d’une violence économique à une violence sociale (et à une atteinte aux valeurs de la République accessoirement).
La violence sociale traverse toute l’œuvre de Christine Angot que ce soit lorsqu’elle raconte l’attitude de son père vis-à-vis de sa propre mère dans Un amour impossible ou lorsqu’elle décrit ce que lui fait subir son père dans Une semaine de vacances.
Le père s’affranchit de toute règle mais pas vis-à-vis de tout le monde, seulement vis-à-vis de ceux qu’ils jugent inférieurs économiquement et socialement (c’est-à-dire Christine et sa mère).

UNE COERCITION PAR LE LANGAGE
Toute personne qui suit une thérapie sait cela : le psy nous demande de parler, de décrire précisément, de nous exprimer pour nous libérer. Et il arrive fatalement un moment où soit nous n’avons plus les mots, soit nous ne savons pas lesquels utiliser pour nous faire comprendre, voire nous ne les avons plus, nous sommes muets, on voudrait dire et on ne peut pas.
Quand dans Un voyage dans l’Est, Christine Angot expose son incapacité à dire non, sa tentative désespérée de faire comprendre à son père qu’elle veut des relations normales père-fille, sans pouvoir, pendant longtemps, utiliser un langage clair et des phrases explicites, on réalise que son roman est puissant dans le fond et dans la forme et qu’il devrait être lu par le plus grand nombre en raison de l’intelligence de son questionnement : comment se défendre quand on ne peut pas parler ?
Dans le chapitre où elle évoque son incapacité à trouver les mots, il s’agit du témoignage d’une situation scabreuse : son père se comporte avec elle comme avec une femme avec laquelle il aurait des préliminaires consentis. Mais il s’agit aussi d’un témoignage sur la sidération qui s’exprime à travers le corps et le langage : que se passe-t-il quand on ne peut plus s’exprimer et donc se défendre, se revendiquer comme une personne et non comme un objet ?
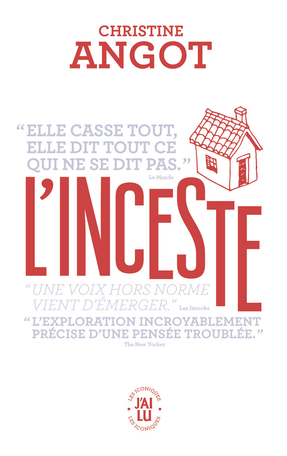
Le prédateur (ici le père) en profite, et aura beau jeu ensuite de prétendre que la victime était consentante, peu claire dans son comportement et il pourra même interpréter, pour se justifier, ce silence traumatique, cette aphasie qui s’incarne même quand l’auteur essaie, avec le recul des années, de reconquérir de l’objectivité et d’analyser ce qui s’est passé.
Le père interdit à sa fille de dire aux autres ce qu’il a fait, non par remords, honte ou peur de la justice, mais parce qu’il est persuadé qu’il réussira à la réduire au silence et qu’il veut garder une belle image.
Homme issu d’une classe sociale supérieure, il sait d’instinct que la parole de sa fille sera jugée, décrédibilisée, minimisée. Il est suffisamment intelligent pour comprendre comme ça marche : une victime qui peine à s’exprimer, qui souffre et qui s’autosabote est considérée par les autres comme « coupable, forcément coupable » pour paraphraser Marguerite Duras.
C’est ainsi qu’il s’arroge le rôle du libertaire, du transgressif, du pionnier, du visionnaire qui s’exprime à la perfection, qui choisit les discours à tenir et l’attitude publique à observer.
Lire Christine Angot, c’est découvrir comment les agresseurs prennent le dessus et comment, même au-delà de leur mort, le bénéfice du doute est tellement fort que la victime le reste présumée pour l’éternité. Un peu comme si une réparation complète était impossible. De quoi devenir fou ou trimballer une souffrance quotidienne, qu’on finit par cacher, car les autres se lassent d’une douleur qui dure.
LA CRUDITE DU LANGAGE AU SERVICE DE LA CATHARSIS
Dans Un voyage dans l’Est, Christine Angot nous raconte l’inceste subi et comment elle est sidérée puis réduite au silence, puis comment elle peine à trouver ses mots. Elle raconte sa lutte pour retrouver le fil des événements, sa méthode pour construire un récit recevable pour une plainte ou pour une thérapie.
Certains passages sont difficiles à lire et il est impossible de rester insensible à ce qu’elle a vécu mais aussi à la puissance de son écriture.
Au-delà de restituer le parcours d’une personne qui essaie de s’en sortir, ce travail sur les mots, qui s’accompagne de la parution régulière de ses livres, illustre bien que Christine Angot est un grand écrivain.
Pour ceux, encore trop nombreux qui voudraient en douter (être victime ou survivante n’accorde hélas aucun passeport de bienveillance et certains tirent sur l’ambulance avec délectation), il suffit de lire le passage où elle retranscrit les mots du père qui aurait dit : « c’est trop bon » alors qu’il frotte son sexe sur celui de sa fille. Un texte de ce genre c’est du napalm, ce n’est pas du voyeurisme, ni de la perversité, c’est de l’écriture réaliste qui permet de se rendre compte réellement des choses, plutôt que de les imaginer et de les minimiser. J’ai pris un très court exemple mais il y en a de nombreux, notamment quand elle retranscrit les échanges où elle négocie pour que son père ne la déflore pas. Ce genre de passage remue les tripes et impossible de rester insensible, de ne pas entendre ce qu’elle dit. Quelle fille peut survivre quand elle a dû négocier avec son père une sodomie pour pouvoir donner sa virginité à l’homme qu’elle aura choisi ? Il faut plus que du courage, c’est une traversée du feu en sachant qu’on va finir carbonisée et que dans notre armoire à pharmacie il y a juste un tube de Biafine…
Pourtant nous accompagnons l’héroïne dans ce récit. Fermer les yeux, les pages, se boucher les oreilles, n’empêcheront pas des situations aussi affreuses. Être informé et s’inspirer de la lutte et du courage qu’il a fallu pour surmonter cette horreur, est important, cela peut sauver des existences et être réparateur pour beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il faut lire Angot et ne censurer aucun mot, même si c’est dur. Il y a chez Christine Angot plus de générosité que de dureté si on sait bien la lire. Elle n’expose pas des choses dures par plaisir ou provocation, à mon avis c’est pédagogique et préventif.
UNE SOCIETE FRANCAISE GANGRENEE PAR LE TABOU DE L’INCESTE
Christine Angot parle dans ses œuvres d’un viol particulier : l’inceste, mais elle ne peut pas être réduite à cela, même si le sujet revient souvent d’une manière à chaque fois « renouvelée », un peu comme si nous suivions l’évolution de ce trauma sur son écriture. Si je devais définir Christine Angot, je dirais qu’elle est avant tout un écrivain. Elle fait œuvre d’écrivain en questionnant le langage sur un sujet qui touche de nombreux lecteurs, même si cela passe par sa douloureuse expérience intime. Elle a récemment utilisé un nouveau medium, la caméra et réalisé un film au cinéma :
Son œuvre s’inscrit dans une réalité. Les dernières enquêtes officielles ont révélé l’ampleur de l’inceste dans la société française. Un observatoire de la protection de l’enfance existe même : l’ONPE.
Les chiffres révélés sont inquiétants : d’après un sondage Ipsos réalisé en 2020, un Français sur 10 affirme avoir été victime d’inceste, soit 6,7 millions de personnes. Cependant 36 % des plaintes pour viol incestueux ont été classées sans suite en 2022.
De nombreux livres ont été publiés dernièrement mais avec L’Inceste, en 1999, Christine Angot fut une pionnière.
Surtout, elle va plus loin que d’autres écrivains, en posant la question de la réception de la parole. Dire c’est bien, mais après ?
LES LIMITES ET LES DANGERS DU « ON VOUS CROIT »
L’inceste est une destruction et le statut de victime enferme la personne dans une case dont il est impossible de s’extraire. Malgré le temps qui passe, malgré ses tentatives de reconstruction, la personne sera toujours cataloguée victime, parfois sans véritable reconnaissance.
Les gens sont souvent à côté de la plaque quand ils parlent d’inceste. Des abrutis ont même parlé d’inceste heureux au sujet d’un père qui vivait avec sa fille (affaire Mannechez) dont l’issue fut fatale au bourreau, à la victime et à un brave homme qui avait essayé d’aider.
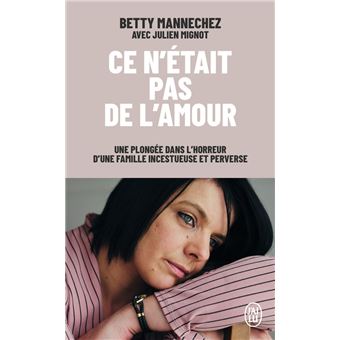
Voici une vidéo où Betty Mannechez raconte son histoire.
Notre époque est pernicieuse et si on peut se féliciter de la reconnaissance des victimes et de la libération de la parole, l’expression « on vous croit » est à double tranchant, comme le rappelle Christine Angot dans une interview, en vidéo, plus bas.
Car cette expression « on vous croit » devrait être une première étape à faire suivre d’une autre. Tout ne s’arrête pas à la révélation. Ok, on l’a dit, et après ? Qu’en est-il de l’écoute et du processus de libération ? Que la société dise : « on vous croit » sans ensuite écouter, sans laisser les victimes s’exprimer en détail car cela serait trop dur à entendre pour certains, réduits finalement celles-ci au silence.
Tout le monde n’a pas les ressources d’écrire un livre et d’en faire la promotion dans les médias. Certaines personnes sont même tellement réduites à l’état d’objet qu’elles n’ont pas eu accès à une éducation correcte et ne savent pas lire ou écrire. D’autres aussi ne souhaitent pas médiatiser leurs vécus.
Voici une vidéo où Christine Angot évoque les conséquences de l’inceste dans l’émission La Grande Librairie sur France 2 à l’occasion de la sortie de son film (et où elle explique de manière plus élaborée ce que nous avons dit plus haut au sujet de l’expression on vous croit). C’est très émouvant et intelligent.
C’est pourquoi, à mon avis, l’œuvre de Christine Angot, où elle partage ses ressentis, son histoire mais aussi des détails très crus, est en fait d’utilité publique. On dit que l’artiste a pour fonction de révéler aux hommes du quotidien, un autre monde et d’en rapporter des visions inédites. Cela ne veut pas dire que l’artiste doit être un bouffon qui nous fait rire. Parfois, ses révélations peuvent être sombres mais nécessaires. Avec ses romans, Christine Angot réussi à révéler tout en introduisant une dimension et une question supplémentaires : celle de l‘après et comment ne plus être victime, comment passer à autre chose ?
Notre société hautement technologique ne pourra jamais rivaliser avec l’humain. Lire des livres, dont ceux de Christine Angot, lire et voir les œuvres d’artistes qui ont été confronté à des sujets aussi graves que le viol, permet au-delà de la catharsis, de créer une société qui briserait les tabous non par voyeurisme mais pour informer et protéger ses citoyens, au lieu de les protéger « pour de faux » par le biais d’une censure à des mots qui seraient soi-disant gênants.

A noter, que Christine Angot, auteur reconnue, adaptée au cinéma, et qui vient de sortir un film intitulé Une famille, a dû affronter de nombreuses moqueries et attaques à ses débuts, pour faire entendre sa vérité. La lire ce n’est pas que de la sororité, c’est aussi regarder en face la noirceur de l’âme humaine, les tourments des victimes, leurs combats et refermer un livre en ayant appris quelque chose sur nous et sur l’humanité.
Pour ceux qui veulent connaître tout le parcours de Christine Angot, voici le lien vers sa page Wikipédia. Vous verrez que même sur celle-ci quelques remarques ne sont pas tendres et pour ceux qui voudraient acheter ses livres au format poche voici le lien vers les éditions J’ai lu.
En conclusion, je voulais souligner que je ne suis pas une fan hardcore (extrême) de Christine Angot, même si j’aime ses livres, je suis fan hardcore de Guy de Maupassant qui lui aussi à révélé la noirceur de l’âme et les paradoxes des passions. Je précise cela pour contrer ceux qui croiront à un article promotionnel ou panégyrique.
Il serait temps également d’être vigilant vis à vis cette nouvelle pratique de censure du langage mis en place par les réseaux et plateformes américaines. La France est très différente dans sa mentalité de l’anglo-saxonne et prions de ne jamais leur ressembler malgré la mondialisation. Méfiance donc vis-à-vis des mots bipés ou censurés. Laissez-nous la liberté de nommer un chat un chat, même si les griffes du langage nous lacèrent le cœur.
Un cœur ensanglanté n’est pas une mauvaise chose ou choquante : le Sacré-Cœur était plein de rédemption, de transformation et d’amour, et c’est ce dont on besoin les victimes de viol, ainsi que l’humanité en général, y compris ceux qui s’en défendent.
Lien vers l’épisode 1 : ARTEMISIA, être une femme peintre au 17e siècle.
(A suivre prochainement, notre troisième et dernier article sur le viol et l’art).


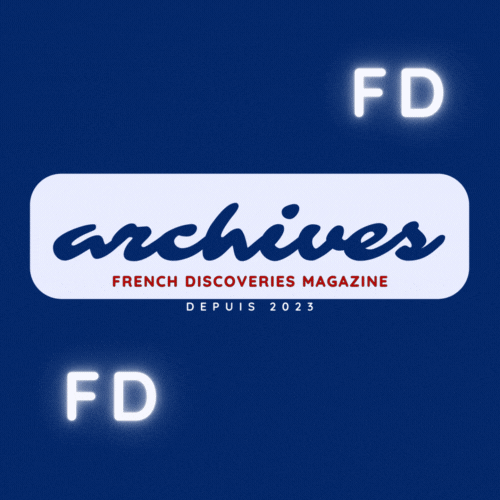
Laisser un commentaire