Connaissez-vous Le tour de la France par deux enfants ? écrit par G. Bruno, pseudonyme d’une femme ? Cet ouvrage a connu un succès colossal et on compte plus de 500 éditions de cette méthode de lecture, très pratique quand on apprend le français !
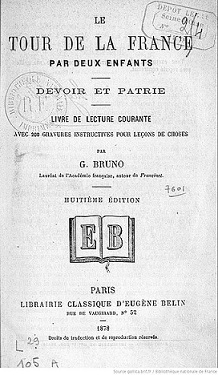
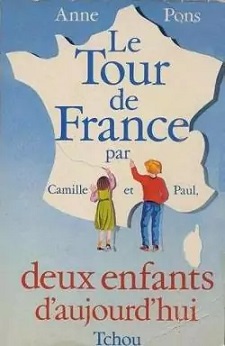
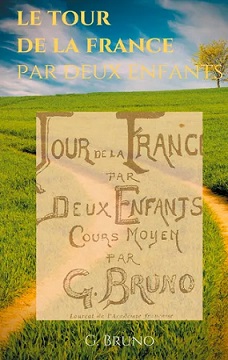
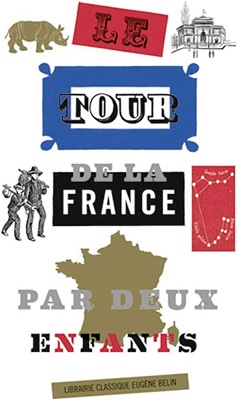
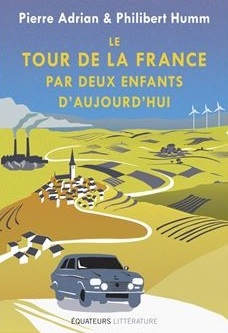
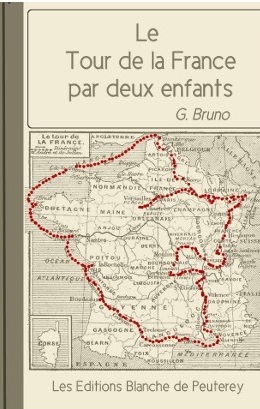
Après une présentation du livre nous ferons une dictée et ensuite en auto-correction vous pourrez voir le corrigé et connaitre ainsi votre score !
N’hésitez pas en commentaires à poser toutes vos questions.
Faire une dictée est une activité très utile quand on apprend une langue et notamment le français car mobilise la compréhension orale, la production écrite, la mémoire et vous fait pratiquer et réviser l’orthographe, la conjugaison…Cela vous fait aussi vous poser de bonnes questions sur les accords, les adjectifs, pourquoi ceci, pourquoi cela.
Faire des dictées fait vraiment progresser !
Dans cette vidéo une dictée de niveau A2/B1.
Bonne écoute et bon courage !
LE TEXTE DE LA DICTEE CORRECTION
« Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d’un devoir à remplir.
Par un épais, brouillard du mois de septembre deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu’on appelle porte de France. Chacun d’eux était chargé d’un petit paquet de voyageur, soigneusement attaché et retenu sur l’épaule par un bâton. Tous les deux marchaient rapidement, sans bruit ; ils avaient l’air inquiet. Malgré l’obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d’obscurité encore et s’en allèrent cheminant à l’écart le long des fossés. » Le Tour de la France par deux enfants, G. Bruno, 1877, texte de la première édition, dans le domaine publique
EXPLICATION DU CORRIGE
Toute la conjugaison des verbes, pour tous les temps grammaticaux, pour apprendre et vérifier, ici.
Temps grammaticaux utilisés dans le texte :
- Dans la maxime en italique :
Le présent : Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d’un devoir à remplir.
L’infinitif de soutient est soutenir, 3e personne du singulier.
Soutenir est un verbe du 3e groupe.
Quelle est la valeur du présent dans cette phrase? Ici il exprime une vérité générale.
- Dans la phrase « Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu’on appelle porte de France ».
Appelle infinitif appeler, 3e personne du singulier avec « on » qui a valeur de généralité.
Quelle est la valeur du présent dans cette phrase? Ici il exprime une habitude, un usage commun, cela est renforcé par l’emploi du pronom indéfini « On ».
L’imparfait :
Les verbes suivants sont à l’imparfait dans ce texte :
- Dans la phrase « Par un épais, brouillard du mois de septembre deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine ».
Sortaient infinitif sortir 3e groupe, 3e personne du pluriel.
Quelle est la valeur de l’imparfait dans cette phrase? Evocation d’une action passée en cours de déroulement. Grâce à l’emploi de l’imparfait, nous accompagnons les enfants, nous sommes davantage plongés dans le récit, nous visualisons vraiment l’action.
- Dans la phrase : « Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu’on appelle porte de France. »
Venaient infinitif venir, 3e groupe, 3e personne du pluriel.
Quelle est la valeur de l’imparfait dans cette phrase? Ici l’imparfait décrit les circonstances et actions autour d’un événement. Les enfants quittent la ville mais qu’ont-ils fait avant ? Ils viennent juste de franchir une grande porte. En employant l’imparfait, l’auteur nous décrit avec précision l’enchaînement des actions dans le passé.
- Dans la phrase : « Tous les deux marchaient rapidement, sans bruit. »
Marchaient infinitif marcher, verbe de 1er groupe, 3e personne du pluriel.
Quelle est la valeur de l’imparfait dans cette phrase? L’imparfait décrit l’action en cours de déroulement au moment de la description. Grâce à l’emploi de ce temps nous savons que l’action est « in progress » : ils marchaient donc ils n’ont pas encore fini leur action totalement, ils sont en train de quitter la ville et l’auteur nous décrit cela. A noter, l’adverbe « rapidement » qui nous donne des précisions sur la manière dont ils marchaient.
- Dans la phrase : « ils avaient l’air inquiet. »
Avaient infinitif avoir, verbe auxiliaire, 3e groupe, 3e personne du pluriel.
Quelle est la valeur de l’imparfait dans cette phrase? L’imparfait permet à l’auteur de nous transmettre l’état d’esprit des personnages au moment où l’action se déroule.
L’imparfait est un temps descriptif.
Les enfants sont au nombre de deux donc la conjugaison à l’imparfait des verbes relevés porte la marque du pluriel : pour la 3e personne du pluriel à l’imparfait, la terminaison est -aient.
Plus-que-parfait :
- Dans la phrase : « Chacun d’eux était chargé d’un petit paquet de voyageur, soigneusement attaché et retenu sur l’épaule par un bâton. »
Etait chargé infinitif être, 3e groupe, 3e personne du singulier.
Le plus-que-parfait est créé avec l’auxiliaire à l’imparfait + participe passé.
Attention : avoir chargé ne signifie pas du tout la même chose qu’être chargé.
Ici les enfants portent un paquet avec leurs affaires de voyage.
Avoir chargé veut dire avoir rempli quelque chose, par exemple : avoir chargé le camion de déménagement avec les cartons.
Être chargé n’a rien à voir, car signifie porter quelque chose mais aussi avoir la responsabilité. Cela dépend du contexte. Par exemple : être chargé de famille signifie avoir la responsabilité de prendre en charge une famille au niveau économique et émotionnel. Un chargé d’études est une personne dans l’entreprise en charge des études qui peuvent être variées : marketing, commerciales, satisfaction client, études sociologiques, démographiques, etc.
Quelle est la valeur du plus-que-parfait dans cette phrase?
Le plus-que-parfait décrit une action passée qui s’est déroulée avant une autre action passée. Avant de quitter la ville, les enfants avaient chargé sur leurs épaules leurs paquets.
Le passé simple :
Les verbes suivants sont au passé simple :
- Dans la phrase : « ils cherchèrent plus d’obscurité encore et s’en allèrent cheminant à l’écart le long des fossés. »
Cherchèrent, infinitif chercher, 3e personne du pluriel.
Allèrent, infinitif aller,3e personne du pluriel.
Quelle est la valeur du passé simple dans cette phrase ?
L’emploi du passé simple permet d’exprimer les actions dans le cadre du récit, sa fonction est narrative.
Les accords d’adjectifs :
- la grande porte fortifiée : porte est un nom féminin singulier donc l’adjectif s’écrit avec la marque du féminin au singulier car en français l’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie.
- ils avaient l’air inquiet : c’est l’air qui est inquiet, voilà pourquoi l’adjectif est au singulier.C’est un piège car on aurait envie de mettre un « s » à l’adjectif car il y a deux enfants, mais l’adjectif qualifie la locution « avoir l’air » qui est au singulier.
- attaché et retenu : ces adjectifs qualifient le groupe nominal «petit paquet » qui est au masculin singulier.
- l’obscurité déjà grande : grande est au féminin car qualifie le mot obscurité qui est féminin. Le « e » finale est la marque du féminin et à l’oral j’entends la consonne finale car le mot ne se termine pas par une consonne, et de plus, est au féminin. Voir notre vidéo sur la prononciation de la consonne finale.
Orthographe :
Pourquoi il y a un accent circonflexe sur le mot « bâton » ?
Parce qu’à l’origine il y avait un « s » on écrivait « baston » et d’ailleurs ce mot est relié à l’idée de bastonnade, de bastonner qui signifie donner des coups de bâton et donc se battre ou corriger quelqu’un physiquement.
Avec le temps, l’habitude d’écrire le « s » a disparue et l’accent circonflexe est apparu, rappelant l’existence ancienne du « s ». Ce n’est pas le seul mot de la langue française dans ce cas, par exemple : forêt, château, gâteau…
La symbolique :
A noter que les deux jeunes voyageurs quittent la ville à pied, chargé d’un paquet de voyageur contenant leurs maigres biens, au bout d’un bâton : cela qui fait penser à la carte du tarot de Marseille, Le Mat, qui signifie l’idée d’un nouveau départ.
Il s’agit donc d’une image archétypal symbolisant un commencement, ici utilisé pour parler du commencement de l’intrigue et de la nouvelle existence des enfants.
L’adjectif inquiet exprime bien la réaction la plus commune face au changement, notamment pour les jeunes lecteurs qui découvrent ce récit. Par empathie, ils se mettent à la place des enfants et leur intérêt pour ceux-ci et pour l’histoire est éveillé.
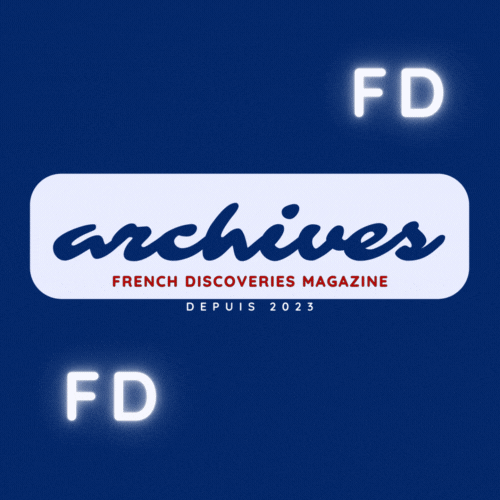
Laisser un commentaire